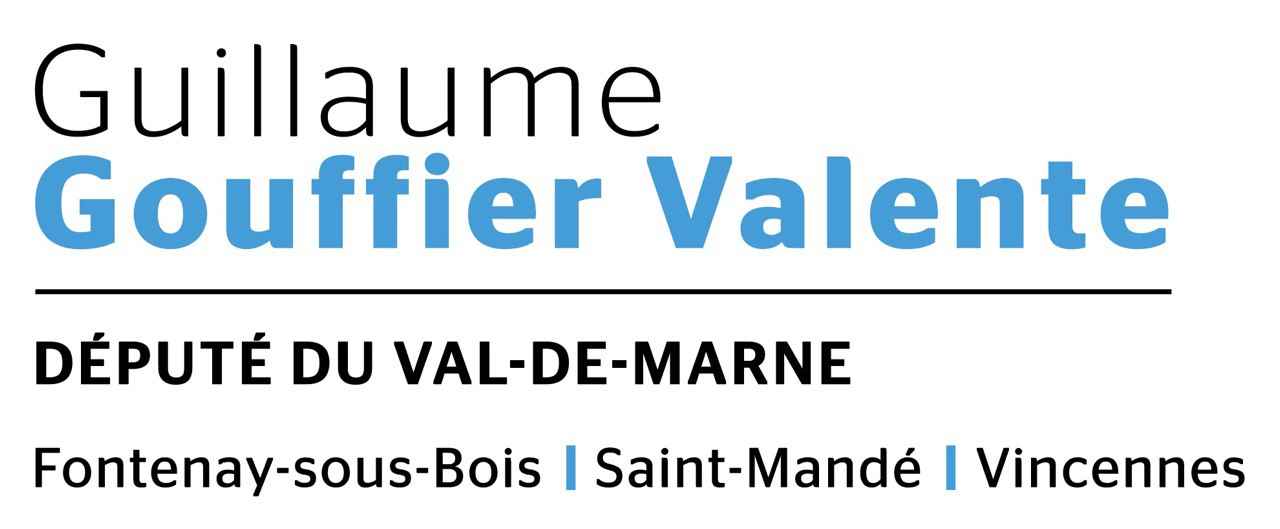Aide à mourir : l’Assemblée nationale adopte la loi en première lecture

« Préservons notre ambition écologique »
17 juin 2025
Au salon de l’AMIF 2025 : engagées pour la parité en politique locale
30 juin 2025Aide à mourir : l’Assemblée nationale adopte la loi en première lecture
Après un chemin législatif long et semé d’embuches, l’Assemblée nationale a adopté le 27 mai dernier deux textes sociétaux majeurs et attendus par une grande partie des Françaises et des Français : un texte autorisant l’aide à mourir et un autre visant à développer les soins palliatifs.
Le Gouvernement du Premier ministre Gabriel Attal, dans la suite des travaux lancés par sa prédécesseure Elisabeth Borne, avait présenté au printemps 2024 un projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, débattu dans le cadre d’une commission spéciale du 22 avril au 7 juin 2024. Toutefois, la dissolution de l’Assemblée nationale avait malheureusement interrompu l’examen du texte. Dès son arrivée à Matignon, le Premier ministre François Bayrou annonça que la discussion du projet de loi initial serait poursuivie sous la forme de deux textes scindés entre celui sur les soins palliatifs d’un côté et celui relatif à l’aide à mourir de l’autre.
Olivier Falorni, député fortement impliqué sur les travaux relatifs à la fin de vie depuis longtemps, a fait le choix, en tant que rapporteur général sur le texte sur l’aide à mourir de reprendre les dispositions du texte tel qu’amendé avant la dissolution et l’interruption des débats. Je tiens à saluer son engagement et son travail depuis tant d’années.
1/ Proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir
Alors que plus de 2600 amendements avaient été déposés par seulement quelques députés de droite conservatrice et du Rassemblement rational, le texte a été adopté en première lecture par 305 voix pour, 199 voix contre et 57 abstentions. Vous pouvez retrouver le scrutin public et le détail des votes ici.
- Les conditions cumulatives à remplir pour être éligible à l’aide à mourir
Le texte définit clairement le principe de l’aide à mourir. A l’article 2, il est précisé que « le droit à l’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. » L’on parle ainsi du principe de « l’aide au suicide » puisque l’administration de la substance par un professionnel de santé est réservée aux personnes dans l’incapacité physique de le faire. Parler d’euthanasie est faux. Le principe est l’auto administration.
La demande d’aide à mourir fait l’objet d’une véritable procédure d’examen. D’ailleurs, chacun a le droit de recevoir une information claire et compréhensible concernant l’aide à mourir et savoir s’il est éligible. Le texte crée ainsi un délit d’entrave à l’aide à mourir puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Il s’agit notamment du fait d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir ou la transmission d’allégations de nature à induire intentionnellement en erreur dans un but dissuasif.
Pour pouvoir bénéficier d’une aide à mourir, plusieurs conditions administratives doivent être remplies :
- Il faut être majeur
- De nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France
Mais aussi évidemment des conditions médicales :
- Le patient doit être atteint d’une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital,
- En phase avancée ou terminable,
- Et présenter une souffrance physique ou psychologique constante insupportable et réfractaire aux traitements
Il faut noter qu’une souffrance psychologique ne peut pas seule permettre l’accès à l’aide à mourir.
NB : la notion de « phase avancée » de la maladie a été explicitée par la Haute Autorité de santé (HAS) dans un avis de mai 2025 et consiste en « l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie ».
Enfin, le patient doit pouvoir exprimer de manière libre et éclairée sa demande. De fait, les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ne sont pas concernées par l’aide à mourir.
2. La demande d’aide à mourir et le début de la procédure
Le texte prévoit tout un procédé à respecter en bonne et due forme pour déposer une demande d’aide à mourir.
Ainsi le patient doit faire sa demande par écrit, de manière expresse, auprès d’un médecin qui n’est ni un parent, ni un ayant droit de la personne malade. Si la personne n’a pas la capacité d’écrire sa demande, elle doit être formulée par un moyen d’expression adapté à ses capacités. La téléconsultation n’est pas autorisée.
Une fois la demande effectuée, le médecin qui reçoit la demande d’aide à mourir doit se prononcer dans un délai de 15 jours. Le médecin doit informer pleinement la personne sur son état de santé et les perspectives d’évolution, les traitements disponibles et doit lui proposer de bénéficier de soins palliatifs. Il doit lui indiquer qu’il peut renoncer à tout moment à sa demande mais aussi lui expliquer les conditions de mise en œuvre de l’aide à mourir. Le médecin doit recueillir l’avis d’un autre médecin n’intervenant pas auprès de la personne et peut recueillir l’avis d’autres professionnels.
La personne ayant effectué la demande dispose d’un délai de réflexion de 2 jours à compter de la notification afin de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. Le patient peut demander un report de l’administration de la substance létale et la procédure est suspendue, le produit est immédiatement détruit.
3. L’administration de la substance létale
La personne choisit conjointement avec le médecin la date d’administration de la substance létale et le lieu si l’administration a lieu en dehors de son domicile. Les députés ont interdit les lieux publics (comme les voieries, places, parvis ou les plages etc.). Pour aider les personnes accompagnants le patient recevant l’aide à mourir, les professionnels de santé devront leur indiquer l’existence de dispositifs de soutien et d’accompagnement psychologique.
Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est plus obligatoire mais il doit rester suffisamment près et en vision directe de la personne pour pouvoir agir en cas de difficultés. Le certificat de décès est établi par le médecin.
Pour prendre en considération les réticences de certains membres du corps médical, une clause de conscience spécifique, comme celle qui existe pour l’interruption volontaire de grossesse a été instituée, assortie d’une obligation pour le médecin qui refuse de procéder à l’aide à mourir de réorienter vers un autre professionnel sans délai.
4. Une partie judiciaire avec des dispositions pénales et de contrôle
Compte tenu de l’importance de la décision prise, est instituée une commission chargée du contrôle et de l’évaluation de l’aide à mourir qui contrôle a posteriori les conditions requises à chaque étape des procédures, enregistre l’identité des professionnels de santé s’étant volontairement déclarés comme disposés à la mise en œuvre de la procédure et aura la possibilité de signaler au procureur de la République les faits susceptibles de constituer un crime.
Du reste, la décision du médecin se prononçant sur l’aide à mourir ne peut être contestée que par la personne ayant formulé la demande devant une juridiction administrative.
Enfin, le texte oblige les contrats d’assurance décès à couvrir le risque de décès en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir.
Rappel du cadre actuel en France : le cadre juridique en vigueur est issu de la loi du 2 février 2016, dite « Claeys-Leonetti », qui a notamment reconnu le droit à une fin de vie digne et au meilleur accompagnement possible de la souffrance. Cette loi a également autorisé la sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à l’arrêt des traitements de maintien en vie (dont l’hydratation et la nutrition), pour les personnes souffrant d’une affection grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé à court terme (quelques jours ou quelques heures) et subissant une souffrance réfractaire aux traitements.
Avant les débats récents au Parlement, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a rendu en septembre 2022 un avis sur la fin de vie qui ouvre la voie à une « aide active à mourir » strictement encadrée.
Par la suite, la Convention citoyenne pour la fin de vie a estimé en avril 2023 que le cadre actuel d’accompagnement de la fin de vie n’était pas adapté aux différentes situations rencontrées et appelait à une nouvelle discussion sur le sujet.
2/ Proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement
En parallèle, la proposition de loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs a été adoptée en première lecture à l’unanimité à l’Assemblée nationale.
Pourquoi ce texte ? Ce texte vise à répondre aux problématiques d’accès aux soins palliatifs. En effet, la France se classe au 15erang parmi les pays de l’OCDE en matière de densité de l’offre de services. Dans un rapport de juillet 2023, la Cour des comptes soulignait que les parcours de soins palliatifs étaient trop centrés sur l’hôpital, au détriment des soins de ville et des EHPAD. 190 000 patients bénéficient aujourd’hui de soins palliatifs, soit une réponse à hauteur d’à peine 50% des besoins. Or, d’après la Cour des comptes, 440 000 personnes devront être prises en charge par des structures de soins palliatifs d’ici 2035, ce qui représente une augmentation de 15% par rapport à 2023.
Dans les mesures phares de ce texte, la notion de soins d’accompagnement est précisée pour y inclure systématiquement la mention de « soins palliatifs ». Cette notion englobe une prise en charge globale de la personne malade grâce à des soins qui répondent à des besoins physiques, psychologiques et médico-sociaux pour préserver la dignité, l’autonomie et le bien-être du malade.
Le texte prévoit aussi la structuration d’organisations territoriales spécifiques relatives aux soins palliatifs pilotées par les Agences Régionales de Santé pour assurer la coordination des intervenants dans les domaines sanitaire, médico-social et social.
Pour les personnes en fin de vie dont l’état médical serait stabilisé, qui ne souhaiteraient pas ou ne pourraient pas rester à domicile mais pourraient bénéficier de soins d’accompagnements, des « maisons d’accompagnement » spécifiquement dédiées seront créées. L’objectif est d’avoir une maison par département à horizon 2034.
L’article 14 du texte instaure le « plan personnalisé d’accompagnement », dans une logique d’anticipation, de coordination et de prise en charge sanitaire, psychologique, sociale et médicale de la personne diagnostiquée. La possibilité de rédiger ses directives anticipées est encouragée et ces dernières peuvent désormais être enregistrées dans l’espace numérique « Mon espace santé ». Une campagne d’information nationale est d’ailleurs prévue pour sensibiliser l’ensemble de la population à ce procédé important des directives anticipées.