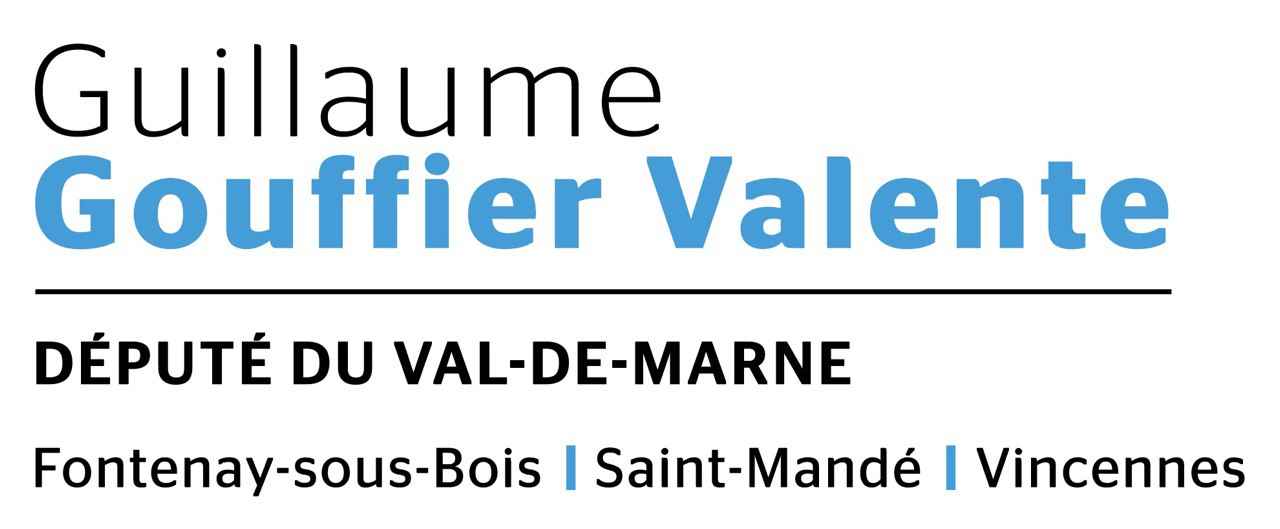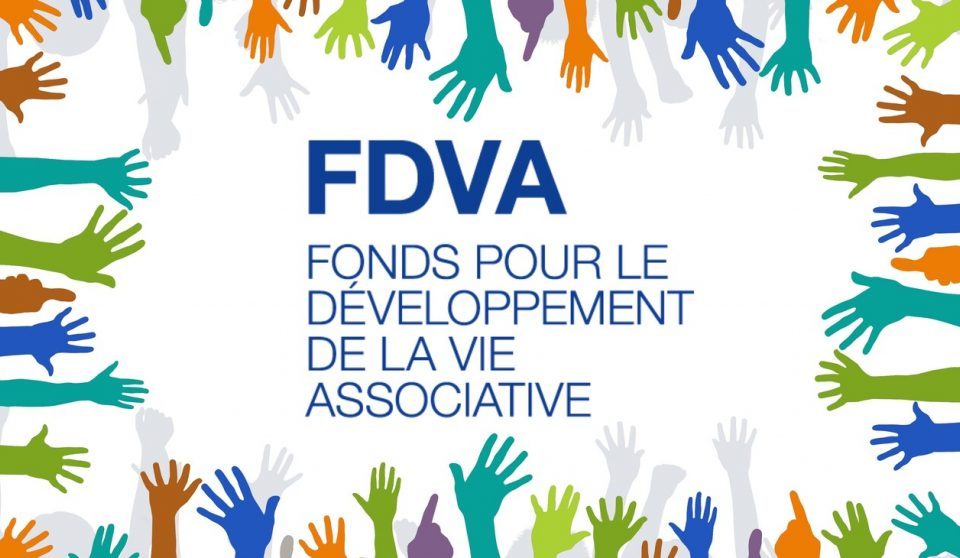Désinformation climatique : « Face à la dégradation du débat public, le législateur doit prendre sa part pour préserver un socle de réalité commun »

Futur budget de l’UE : « L’Europe a besoin de nouvelles ressources solidaires et écologiques »
8 septembre 2025
Journée des associations 2025 – mettre à l’honneur l’engagement de toutes et tous
9 septembre 2025Désinformation climatique : « Face à la dégradation du débat public, le législateur doit prendre sa part pour préserver un socle de réalité commun »
Avec une quarantaine de mes collègues parlementaires, je lance un appel pour défendre le droit à l’information. Face à la montée de la désinformation, aux confusions entre opinions et faits scientifiques, et à la fragilisation du débat public sur des sujets aussi cruciaux que l’écologie et la santé, nous souhaitons légiférer pour lutter contre la désinformation climatique. Préserver un « socle de réalité commun », c’est protéger notre démocratie et donner aux citoyens les moyens de faire des choix éclairés.
« Les récents débats autour de réintroduction de l’acétamipride l’ont montré : nous peinons à discuter collectivement d’enjeux sanitaires et environnementaux, tant la frontière entre opinion et faits scientifiques se brouille. Cette confusion touche à la fois les prises de parole politiques et le cadrage médiatique.
La mobilisation contre la proposition de loi Duplomb a révélé les carences du traitement médiatique : mise en doute d’études attestant de la toxicité du pesticide, valorisation de l’avis de l’EFSA au détriment de ceux de l’Anses, l’Inserm, de l’Inrae, de l’Ifremer ou encore de l’IBPES, au profit d’enjeux économiques.
Pire, à mesure que la pétition citoyenne franchissait le million, puis les deux millions de signatures, des responsables politiques ont accusé le débat public d’être victime de désinformation.
« Préserver un socle de réalité commun »
Une telle dérive compromet à la fois notre aptitude collective à faire des choix éclairés et la capacité des médias à garantir un débat public intègre : nous ne pouvons accepter que la discussion publique se structure autour d’affirmations fausses, vérifiables et non contredites, telles que : « L’acétamipride est autorisé partout en Europe car elle n’a pas été jugée par les scientifiques européens comme dangereuse pour l’environnement et la santé humaine » (Annie Genevard sur TF1, 30 juin).
Face à la dégradation du débat public, le législateur doit prendre sa part pour préserver un socle de réalité commun. La désinformation climatique se normalise et compromet la qualité du travail parlementaire. Car la désinformation régnant autour de l’acétamipride n’est pas un cas isolé. Lors de la panne électrique en Espagne et au Portugal, en avril dernier, plusieurs chaînes d’information ont relayé sans preuve des accusations visant les énergies renouvelables. L’absence de contradiction journalistique a produit un effet de vérité illusoire, jetant le doute sur leur efficacité en termes de transition énergétique.
De telles affirmations, lorsqu’elles ne sont pas corrigées, fragilisent le débat public. En juin, cette défiance a même nourri le vote d’un amendement demandant un moratoire sur les renouvelables, introduit lors de l’examen de la proposition de loi Gremillet.
La désinformation climatique est la pointe émergée de l’iceberg d’un backlash environnemental plus large, qui cible les décideurs. L’usage de certains discours dans l’espace médiatique – qu’il s’agisse de masquer la nocivité avérée de certains produits, de discréditer les solutions ou de stigmatiser les acteurs de la transition – est stratégique.
En l’absence de contradiction journalistique exigeante, ces récits imposent des vérités alternatives, où les faits deviennent des opinions discutables. Ils contribuent à dégrader les exigences d’exactitude et de rigueur de l’information, pourtant au cœur des obligations des médias vis-à-vis de l’Arcom, et sapent la confiance du public dans la parole politique et la défense de l’intérêt général.
« C’est notre capacité à faire France qui est menacée »
Ce brouillage n’est pas seulement une dérive : il refaçonne en profondeur le cadre du débat public, compromet le travail parlementaire et complique toute décision collective fondée sur la science.
Une mobilisation commune est nécessaire pour que les journalistes réaffirment leur rôle de contre-pouvoir, que les responsables politiques défendent l’intégrité de l’information, et que les citoyens puissent accéder à des clés de compréhension fondées sur la science.
C’est notre capacité à faire France qui est menacée. La défense de l’intégrité de l’information doit devenir une priorité législative. Malgré les efforts de formation entrepris par les médias depuis plusieurs années et la création du Conseil de déontologie journalistique et de médiation (CDJM), les garanties actuelles sont insuffisantes pour assurer l’impartialité, la rigueur et l’honnêteté de l’information environnementale. Or, ces conditions sont essentielles au débat démocratique.
La Charte des journalistes de Tunis de 2019, qui consacre les principes de prudence, de vérification et de distinction entre faits et opinions, reste trop peu appliquée. Le droit d’accès à l’information environnementale, protégé par l’article 7 de la Charte de l’Environnement de 2004, demeure fragilisé par l’absence d’un socle juridique robuste.
Ce constat est aujourd’hui partagé de manière transpartisane à l’Assemblée. Auditionné avant sa nomination, le nouveau président de l’Arcom, Martin Ajdari, a rappelé que le Parlement devait jouer un “rôle d’aiguillon” en la matière.
Parce que la vigilance passive ne suffit plus pour protéger le droit à l’information, l’heure est venue pour le législateur d’agir, en :
– Incitant les médias à définir des standards partagés pour le traitement des enjeux environnementaux.
– Protégeant le droit à une information fiable, condition première d’un débat public éclairé et d’une démocratie résiliente.
– Dotant l’Arcom de compétences adaptées pour répondre de manière efficace et proportionnée à la désinformation climatique. »
Retrouver La Tribune publiée dans Ouest France ici : https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/tribune-desinformation-climatique-plus-de-40-deputes-appellent-a-legiferer-6658ebd0-899a-11f0-86eb-dac26b435301
Retrouver la liste des signataires ci-dessous :
Stéphane Delautrette, député de la Haute-Vienne (Socialistes). Cosignataires : Fatiha Keloua Hachi, députée de Seine-Saint-Denis, présidente de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation (Socialistes) ; Fabrice Barusseau, député de Charente-Maritime ; Mickaël Bouloux, député d’Ille-et-Vilaine ; Pierrick Courbon, député de la Loire ; Alain David, député de la Gironde ; Fanny Dombre Coste, députée de l’Hérault ; Iñaki Echaniz, député des Pyrénées-Atlantiques ; Denis Fégné,député des Hautes-Pyrénées ; Pascale Got, députée de la Gironde ; Emmanuel Grégoire, député de Paris ; Ayda Hadizadeh, députée du Val-d’Oise ; Chantal Jourdan, députée de l’Orne ; Estelle Mercier, députée de Meurthe-et-Moselle ; Marc Pena, député des Bouches-du-Rhône ; Christine Pirès Beaune, députée du Puy-de-Dôme ; Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle ; Claudia Rouaux, députée d’Ille-et-Vilaine ; Sandrine Runel, députée du Rhône ; Isabelle Santiago, députée du Val-de-Marne ; Céline Thiébault-Martinez, députée de la Seine-et-Marne, député du Nord ; Arthur Delaporte, député du Calvados ; Paul Christophle, député de la Drôme ; Pierre Pribetich, député de la Côte-d’Or ; Joël Aviragnet, député de la Haute-Garonne ; Christophe Proença, député du Lot ; Océane Godard, députée de la Côte-d’Or ; Thierry Sother, député du Bas-Rhin ; Mélanie Thomin, députée du Finistère ; Philippe Naillet, député de la Réunion ; Delphine Lingemann, députée du Puy-de-Dôme (Les Démocrates) ; Hubert Ott, député du Haut-Rhin ; Édouard Bénard, député de Seine-Maritime (Gauche démocrate et républicaine) ; Sandrine Le Feur,députée du Finistère, présidente de la commission du Développements durable et de l’aménagement du territoire (Ensemble pour la République) ; Denis Masséglia, député du Maine-et-Loire ; Guillaume Gouffier Valente, député du Val-de-Marne ; Constance de Pelichy, députée du Loiret (Libertés, Outre-mer, Indépendants et Territoires) ; Pouria Amirshahi, député de Paris (Écologiste et Social) ; Nicolas Bonnet, député du Puy-de-Dôme ; Marie Pochon, députée de la Drôme ; Jean-Claude Raux, député de Loire-Atlantique ; Éva Sas, députée de Paris ; Dominique Voynet, députée du Doubs ; Anne-Cécile Violland, députée de Haute-Savoie (Horizons).