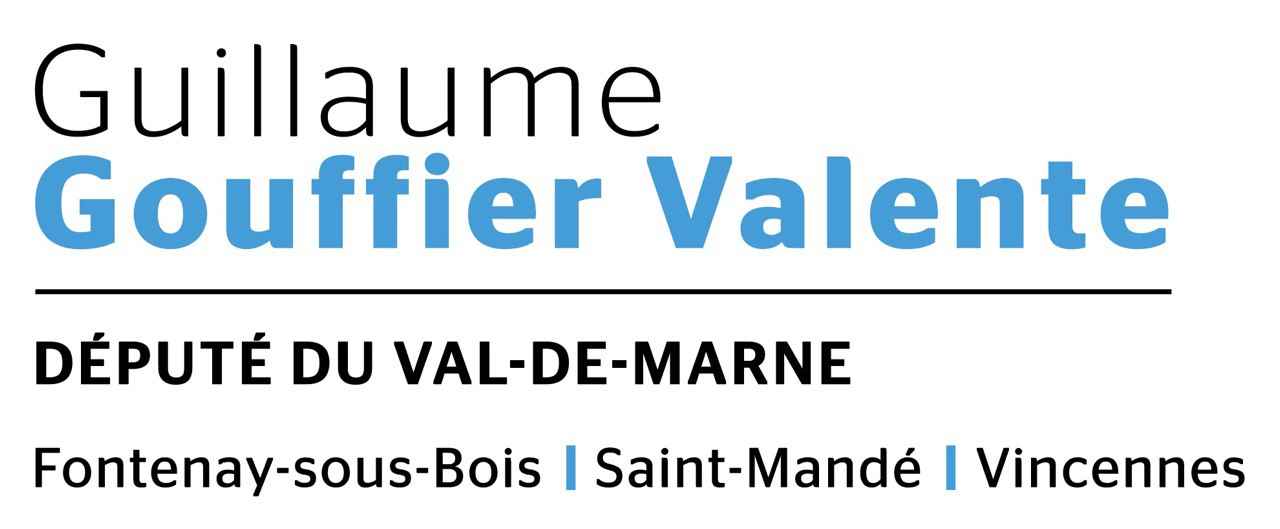Pour un renforcement de la sûreté dans les transports

Généralisation de la solidarité à la source : une mesure de justice sociale
18 mars 2025
Intervention PPL sûreté transport – lecture CMP
18 mars 2025Pour un renforcement de la sûreté dans les transports
La commission mixte paritaire sur la proposition de loi « visant au renforcement de la sûreté dans les transports », dont je suis le rapporteur à l’Assemblée nationale, s’est tenue le jeudi 6 mars et s’est avérée conclusive. Le texte a été définitivement adopté au Sénat le lundi 17 mars (242 voix pour et 34 contre) et à l’Assemblée nationale (303 voix pour et 135 contre) ce mardi 18 mars. Je me félicite de l’accord trouvé avec nos collègues sénateurs sur ce texte attendu par les opérateurs de transports et par les usagers des transports en commun. Retrouvez, à travers cet article, les détails des dispositions de cette proposition de loi.
-
Le contexte de cette proposition de loi d’origine sénatoriale
L’actuel Ministre des Transports, Philippe TABAROT, alors sénateur Les Républicains des Alpes-Maritimes, est à l’origine de ce texte adopté au Sénat en février 2024, après avoir été enrichi par la rapporteure Nadine BELLUROT (LR) sénatrice de l’Indre. Dans le cadre de la navette parlementaire, ce texte a été d’abord examiné une première fois sous la XVIe législature avec le rapporteur Clément BEAUNE. A l’époque, j’avais eu l’opportunité de l’accompagner dans ces déplacements en tant que responsable de texte pour le groupe Renaissance. La dissolution a malheureusement coupé court aux débats. Ces derniers ont repris en commission des Lois, où j’ai été nommé rapporteur sur le texte, texte qui y a été adopté en novembre dernier. Retardé par la censure du gouvernement Barnier, le texte a par la suite été adopté en séance publique à l’Assemblée nationale le mardi 11 février.
La commission mixte paritaire réunie sur ce texte a été conclusive.
De manière générale, ce texte attendu par les opérateurs de transport vise à améliorer la sûreté et ainsi encourager l’utilisation des transports en commun. En effet, le sentiment d’insécurité associé à l’utilisation des transports en commun est assez largement partagé dans notre société. Pour autant, les chiffres le montrent : les cas de violences diminuent – à l’exception insupportable des agressions sexistes et sexuelles – mais c’est la dangerosité des actes qui, elle augmente.
Quelles sont les avancées portées par ce texte pour y remédier ?
-
Le cœur régalien du texte : l’extension des compétences des agents Suge et GPSR
Ce texte cible en grande partie les agents de services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, respectivement les agents de la Sureté ferroviaire (dit SUGE) et du Groupe de protection et de sécurité des réseaux (dit GPSR), dont le professionnalisme et l’engagement au quotidien sont largement à saluer. Je tiens à leur dire personnellement merci.
L’article 1er de la proposition de loi a un double objectif opérationnel : leur permettre de réaliser des palpations de sécurité – prérogative qu’ils ont déjà aujourd’hui avec accord préfectoral préalable – et leur accorder la faculté de confisquer des objets jugés dangereux lorsqu’ils sont découverts à l’occasion de ces palpations, fouilles ou inspections visuelles. Un récépissé serait alors remis à la personne en cas de confiscation d’objets dangereux.
Concernant les palpations, nous avions introduit en commission des lois l’obligation pour les agents de sûreté de prendre en compte l’identité de genre de la personne qui les subit. C’est une question de respect de la dignité de la personne. Reprenant l’idéologie des mouvements anti-droits, le groupe Rassemblement national a malheureusement réussi à faire supprimer cette notion du texte.
L’article 2 renforce la capacité d’intervention de ces agents sur la voie publique en leur accordant un « droit de poursuite ». En parallèle, les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport disposeront d’un pouvoir d’injonction pour faire descendre d’un véhicule une personne ayant commis une fraude ou dont le comportement est susceptible de compromettre la sécurité des personnes ou à l’encontre de quelqu’un qui refuse de se soumettre à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité.
Enfin, l’article 3 donne aux agents Suge et GPSR la faculté d’interdire l’accès aux emprises des gares ou stations à toute personne à leur seuil qui trouble l’ordre public. Des garde-fous sont toutefois prévus afin de préserver les personnes les plus vulnérables, notamment en excluant de ces dispositifs les personnes sans domicile fixe.
Mesure importante, l’article 19 permet aussi de mieux lutter contre la fraude tarifaire, qui représente chaque année des centaines de millions de pertes pour les opérateurs et crée un sentiment d’injustice chez les usagers qui s’acquittent de leur titre de transport. Grâce à ce texte, les agents de contrôle et les agents Suge et RATP pourront obtenir de la part de l’administration fiscale des renseignements sur les contrevenants afin de garantir un meilleur recouvrement des amendes.
-
Des mesures adéquates pour renforcer le continuum de sécurité dans les transports
Les articles 5 et 6 permettent d’éviter des trous dans la raquette en termes de sécurisation dans les transports. En effet, les agents de la Suge pourront intervenir dans les transports publics routiers de substitution, c’est-à-dire les transports qui réalisent un trajet à la place d’un train à la suite d’un incident par exemple (article 5).
L’article 6 lui concerne les agents de police municipale et les autorise à accéder aux espaces de transport sur le territoire relevant de leur compétence. Leur présence sera permise par la signature d’une convention entre les exploitants de service de transport public, les communes et l’autorité organisatrice des mobilités.
L’article 6 bis introduit par amendement en séance à l’Assemblée par le Gouvernement donne la possibilité pour les agents de police judiciaire adjoints (APJA) de contrôler l’identité de personne en cas de constatations d’infractions et de procéder à l’inspection de bagages et de fouilles, en cohérence aux pouvoirs accordés aux agents Suge et GPSR.
Enfin, l’article 7 autorise les agents d’Ile-de-France Mobilités à être affectés dans les salles du centre de coordination opérationnel de la sécurité (CCOS) pour visionner les images des systèmes de vidéoprotection. Cette nouvelle prérogative s’inscrit dans le cadre des missions d’IDFM en tant qu’autorité organisation des transports, telles qu’elles sont définies par la loi d’orientation des mobilités de 2019.
-
Favoriser l’emploi des outils technologiques de manière encadrée
Une partie importante du texte concerne l’utilisation des nouvelles technologies et leur encadrement, notamment l’article 8. Il pérennise l’expérimentation de l’usage des caméras-piétons pour les agents de contrôle. Il s’agit d’une demande forte de la part des opérateurs. En effet, l’expérimentation s’est achevée le 1eoctobre 2024 alors que son bilan s’est avéré quasi-unanime. L’usage de ces caméras individuelles permet de réduire les risques encourus par les agents assermentés en jouant un rôle dissuasif face aux menaces et permet instantanément d’abaisser les cas de tensions. Face à ce constat positif, la proposition de loi propose de la même manière une expérimentation pour les conducteurs d’autobus et d’autocars (article 8 bis).
Une disposition de la proposition de loi cible spécifiquement les transports à Mayotte. Grâce aux travaux de mon collègue Sacha HOULIE sur ce sujet, est autorisé à titre expérimental à Mayotte l’enregistrement d’images sur la voie publique par les opérateurs de transport scolaire routier afin de dissuader les atteintes affectant la sécurité des conducteurs et de leurs passagers.
Dans le sillage de cette mesure, le Gouvernement a porté un amendement pour autoriser l’installation de caméras frontales embarquées sur les tramways pour prévenir les accidents.
Les articles 9 et 10 ont retenu particulièrement notre attention durant nos travaux. Concernant l’article 10 qui autorise la collecte et le traitement des données sensibles par la Suge et le GPSR en cas d’infractions flagrantes punies d’une peine d’emprisonnement, j’ai fait le choix, tout comme la rapporteure Nadine BELLUROT au Sénat de supprimer cet article. Lors des auditions que j’ai menées, la CNIL a indiqué que cette faculté ne nécessite pas de disposition législative et représenterait donc une sur-législation.
L’article 9 quant à lui autorise les agents de sûreté à utiliser des logiciels d’intelligence artificielle de traitement de données non biométriques dans le cadre de réquisitions judiciaires. Il s’agissait d’un traitement de données a posteriori. J’ai préféré également supprimer cet article, la CNIL assurant que les services de sécurité de la SNCF et de la RATP peuvent d’ores et déjà recourir à de tels logiciels. Du reste, mettre dans la loi cet usage très spécifique risquerait de mettre en danger juridiquement les autres acteurs publics lors de l’utilisation de tels logiciels. En effet, ces logiciels sont déjà utilisés par certaines collectivités par exemple.
Avec l’article 9 bis, le Gouvernement a fait le choix de proroger l’expérimentation relative au traitement algorithmique sur les images de vidéoprotection dans le cadre de manifestations sportives ou culturelles. Lancée par la loi relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, l’expérimentation devait s’arrêter au 31 mars 2025, elle sera donc poursuivie jusqu’en 2027.
Enfin, l’article 11, dit « de l’alarme discrète », autorise de manière expérimentale la captation du son en temps réel dans les bus sous certaines conditions. Lorsque le conducteur, profession qui connait un nombre d’agressions exponentiel dans le cadre de l’exercice de leurs missions, se sent en danger, il peut via le système d’une alarme discrète transmettre le son capté uniquement dans son habitacle directement au poste de contrôle et de commandement de l’opérateur. Il ne peut être procédé à aucun enregistrement de cette séquence sonore. Cet article important avait été supprimé en commission des Lois à l’Assemblée. En tant que rapporteur, j’avais proposé une rédaction alternative, en prenant en considération les demandes de précisions des commissaires aux Lois et je me félicite que cet article soit maintenu.
-
Par la sécurisation des lieux de transport, ce texte vise à encourager leur utilisation quotidienne.
L’usage des transports en commun doit être encouragé et passe nécessairement par une tranquillisation des trajets. Cette proposition de loi porte des mesures très concrètes visant à améliorer l’utilisation des transports en commun.
Par exemple, l’article 14 s’attaque au phénomène d’abandons de bagages dans les transports qui perturbe fortement les trafics, est source de tensions pour les usagers et mobilise nos forces de sécurité souvent inutilement. Trois niveaux de sanction sont désormais prévus concernant l’abandon de bagage :
- Les abandons de bagage par imprudence ou négligence sont passibles d’une contravention de 3e
- Lorsqu’il s’agit de véhicules où l’étiquetage est obligatoire, l’abandon de bagage sera puni par une amende de 4e
- Enfin, lorsque le caractère volontaire de l’abandon de bagages ou d’objets est manifeste, il est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5e
En parallèle, le Gouvernement a proposé par voie d’amendement un nouveau dispositif de prévention pour lutter contre l’abandon de bagages, notamment en facilitant l’identification du propriétaire du bagage afin d’obtenir l’assurance qu’il s’agit bien d’un bagage oublié et non d’un colis suspect. Il sera ainsi proposé pour certains réseaux de transport d’étiqueter les bagages en renseignant nom, prénom, numéro de téléphone via un service d’étiquetage anonymisé, par exemple par une étiquette avec un QR code mis en place par les opérateurs.
La proposition de loi contenait dans sa version initiale un article 12 créant un délit d’incivilités d’habitude afin de durcir les sanctions existantes envers certains comportements particulièrement désagréables commis dans les transports. En commission des Lois, j’avais proposé plusieurs réécritures de l’article avec de restreindre le champ du délit d’incivilité d’habitude par exemple en supprimant le fait de ne pas être muni d’un titre de transport valide (qui est déjà puni par le code des transports). Plusieurs autres actes d’incivilités restaient dans le périmètre de l’infraction comme par exemple le fait de détériorer les pancartes ou inscriptions dans les services de transports ou le fait de de servir sans motif légitime d’un signal d’alarme ou encore le fait de faire usage d’instruments sonores qui troublent la tranquillité d’autrui dans les espaces de voyageurs. Cet article aurait permis de sanctionner plus durement des délits aujourd’hui déjà sanctionnés. Néanmoins, la critique émise par de nombreux collègues sur le fait que ce délit d’incivilités d’habitude créerait une « véritable usine à gaz opérationnelle » a retenu toute notre attention lors des travaux de la CMP et l’article a donc été définitivement supprimé.
Dans la continuité de l’article 12, la commission mixte paritaire a tout de même validé la création d’un délit de « train surfing », phénomène montant inquiétant qui consiste à monter sur le toit d’un véhicule de transport ou à s’agripper à ce véhicule lorsqu’il est en marche.
Durant les débats en séance publique au Sénat a été introduite une disposition majeure de la part de la sénatrice Marie MERCIER que je salue. L’article 18 bis permet en effet d’accentuer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les transports. Une incapacité d’exercice de la fonction sera prononcée à l’encontre d’un conducteur de transport de véhicules scolaire ou en contact avec des majeurs en situation de vulnérabilité, condamné pour des infractions violentes ou sexuelles. En parallèle, les opérateurs de transport public de personnes pourront consulter le fichier automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violences (Fijais) pour contrôler les antécédents judiciaires des personnels qu’ils emploient.
Certaines mesures importantes, qui n’avaient pourtant pas été initialement examinées lors des débats au Sénat, ont été jugées suffisamment pertinentes par les membres de la CMP pour être retenues et je m’en félicite. Il s’agit notamment de l’article autorisant les agents Suge à porter un pistolet à impulsion électrique, pour apporter une réponse intermédiaire en cad d’agression avec une arme non létale. Autre mesure, la possibilité accordée à l’opérateur de déposer plainte pour un de ses agents qui aurait été victime d’atteinte à son intégrité physique ou psychiques, menaces ou intimidations.
La sûreté dans les transports est un véritable sujet au croisement d’enjeux à la fois sécuritaires – afin d’assurer la sureté des agents et de tous les usagers – écologiques – par l’encouragement de recourir aux transports en commun – économiques – pour assurer le développement et le bon fonctionnement des lignes et l’entretien des véhicules de transports – sociaux – pour permettre à toutes les usagères et usagers de se sentir en sécurité pour se déplacer chaque jour. A l’heure de l’ouverture à la concurrence de notre réseau de transports, ce sujet me paraît primordial pour anticiper les transitions de notre modèle de transport en commun. C’est pourquoi j’ai tenu à demander au gouvernement la remise d’un rapport dans les deux ans qui viennent sur l’organisation de la sûreté dans les transports à l’heure de de l’ouverture à la concurrence. Je demeurerai vigilant et pleinement mobilisé sur ce sujet.
Pour en savoir davantage, je vous invite à retrouver ci-dessous :
- Mon intervention lors des lectures de la CMP à l’Assemblée nationale :https://guillaume.gouffier-cha.fr/2025/03/18/intervention-ppl-surete-transport-lecture-cmp/
- Mon intervention en séance publique sur le texte : https://guillaume.gouffier-cha.fr/2025/02/10/intervention-en-tant-que-rapporteur-ppl-surete-transports/
- Le communiqué de presse à la suite de la CMP : https://guillaume.gouffier-cha.fr/2025/03/06/cp-cmp-ppl-surete-transport-conclusive/
- Mon interview sur le sujet pour le média Newstank : https://guillaume.gouffier-cha.fr/2025/02/18/news-tank-mobilites-ppl-surete-transports/
- Mon intervention en commission des Lois sur le texte : https://guillaume.gouffier-cha.fr/2024/11/28/intervention_comlois_ppl-transports/
- l’intégralité du rapport sur la PPL : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion_lois/l17b0636_rapport-fond.pdf